Pourquoi les adultes ont-ils peur de la philosophie?
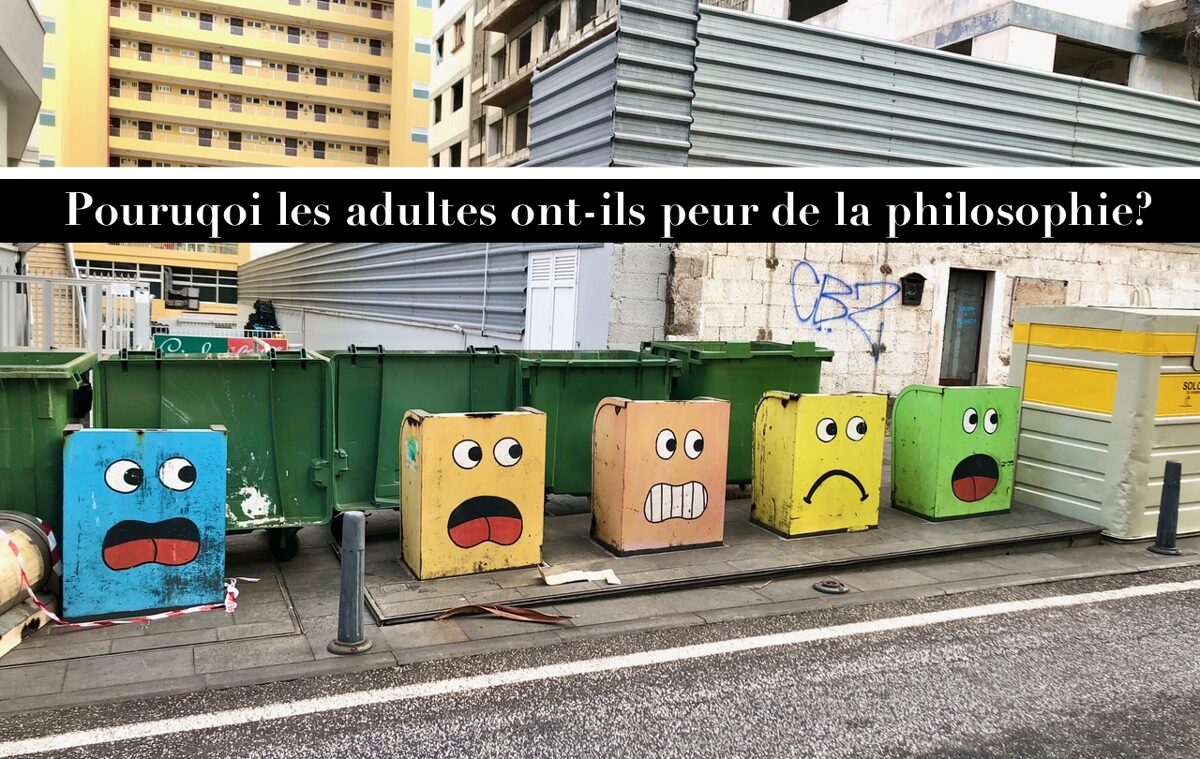
Au seul nom de philosophie, certains et certaines ont les poils qui se dressent sur les bras et les cheveux qui s’hérissent sur la tête. D’autres encore font une moue de dédain avec un « pff » qui exprimerait un « et alors, franchement pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.» D’autres enfin me répondent par un « non merci, c’est pas pour moi ».
Je me suis alors demandé Pourquoi les adultes ont-ils peur de la philosophie?
En questionnant mon entourage, il ressort à part quelques exceptions que la majorité d’entre elles/eux n’ont pas de merveilleux souvenirs de leur expérience des cours de philosophie de terminale. Et pour certains qui comme moi ont poursuivi par la suite la philosophie à l’université, les cours magistraux obscures et rébarbatifs dans des amphithéâtres bondés ont pu contribuer aux raisons pour lesquelles ils ou elles ont changé d’études. Également, ne pas être capable de « faire de la philosophie » (lire des textes philosophiques, faire de bonnes dissertations, élaborer des concepts et jongler avec eux) équivaut dans un imaginaire collectif à ne pas être intelligent/e et fait penser que la philosophie est réservée à une minorité élitiste. La philosophie comme matière complexe enseignée peut rapidement être très lourde, indigeste, démotivante et nous désintéresser. Une conceptualisation à l’extrême qui se déconnecte totalement de notre réalité peut aussi nous faire perdre l’envie de pratiquer la philosophique.
Dans l’enseignement traditionnel les élèves sont sanctionnés et classés par la notation, produisant le concert du ou de la « bonne élève » et développant en même temps le « syndrome du mauvais ou de la mauvaise élève ». Cette étiquette peut nous heurter et nous coller à la peau toute une vie. Devenu adulte, l’idée-même de se retrouver à nouveau dans un contexte scolaire peut alors faire ressurgir des blessures profondes et un mal-être. L’atelier Philo est trop souvent compris comme étant un cours de philosophie. Il provoque ainsi répulsion, rejet et même dédain. Or l’atelier Philo n’est pas un cours de philosophe. Chaque atelier est l’opportunité pour le groupe d’échanger des points de vue sur une question existentielle posée, de pratiquer et développer une interaction et une communication qui permettent de mieux se connaître soi-même et de mieux comprendre les autres ainsi que de développer des savoirs-penser, des savoirs-dire et un « savoir-être et vivre ensemble » (association et fondation SEVE). Questionner, « problématiser », argumenter, verbaliser et conceptualiser: tout y est.
Au fil des ateliers que je conduis depuis juin 2024 auprès des enfants et des adolescents/es, j’observe une facilité étonnante des jeunes à se prêter au jeu du questionnement et du débat à portée philosophique. Plus encore, l’idée de coopérer au sein d’une communauté de recherche à visée philosophique pour résoudre des interrogations les enthousiasme. Les séances qui se terminent par une phase « méta-cognitive » où l’enseignant/e (ou l’enfant expérimenté) restitue le développement de la pensée collective qui est apparue durant l’atelier se conclue très souvent par des applaudissements. Les enfants sont impressionnés par leur travail collaboratif et leur capacité à créer ensemble des idées et de la pensée.
Les enfants dont la maturité se construit peu à peu et lentement sont encore naïfs et peu expérimentés. Ils sont néanmoins capables de réflexion. Ils sont peut-être incapables de vraiment cerner certains concepts évoqués et abordés mais ils sont largement capables d’avoir et de suivre un raisonnement logique. Ils sont surtout totalement à même de se poser des questions existentielles et essentielles sur le monde qui les entoure et sur eux-mêmes. Enfin ils souhaitent malgré la difficulté et l’exigence de l’exercice permettre à chacun et à chacune de s’exprimer et à travailler ensemble.
Philosopher demande un ingrédient indéniable: l’étonnement qui laisse place aux questions. Ce questionnement qui est rapidement suivi par de l’excitation chez l’enfant est suivi souvent chez l’adulte par la peur de dire une bêtise, la peur de ne pas savoir, et même parfois par la honte de ne pas « savoir » répondre « intelligemment ». Les adultes, à cause de ces peurs de s'exposer, d’être jugés et humiliés, semblent abandonner leur enthousiasme face à l’inconnu, au non-connu. Ils exposent parfois des opinions « générales » figées et font appel à de « fausses évidences » rassurantes. Là où l’enfant joue facilement au détective et au petit scientifique, l’adulte semble se braquer, insister et se protéger en se vexant.
Autre élément qui pourrait expliquer ces différences: les enfants n’ayant pas encore eu de cours de philosophie sont peut-être, sans a-priori, beaucoup plus ouverts et curieux à l’idée de rencontrer des philosophes, leurs théories et leurs concepts. l’atelier de philo n’étant pas un cours de philosophie, il est de la responsabilité de l’animateur/trice de mettre au clair les enjeux et les objectifs d’un tel atelier et d’établir et/ou de co-construire d’entrée de jeu des accords et des règles pour le bon déroulement de la séance. La liberté d’expression est essentielle et l’enjeu de bienveillance collective également à énoncé et ambitionner.
Enfin, l’adulte qui a laissé pas mal d’années s’écouler entre ses derniers cours de philosophie et un possible atelier de café Philo ressentirait peut-être aussi un stress immense ou de la frustration avec le sentiment de ne rien avoir appris depuis les bancs du lycée: « Toutes ces années ont passées et je n’en sais toujours pas plus sur Kant, Platon, Heidegger...qui sont-ils? Quels sont les concepts essentiels développés par ces penseurs? » et l’idée de l'inutilité de participer : « J’ai très bien vécu sans la Philo alors pourquoi me confronter à nouveau à ces théories complexes et ces hommes et femmes d’autre temps. »
Dans ce contexte de défiance, comment traverser cette résistance à la philosophie? Comment réinstaller une confiance et un plaisir dans l’acte de philosopher?
Comme l’exprime Emmanuel Kant dans son Traité de pédagogie en 1803, « On ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu’apprendre à philosopher. ». Philosopher ne serait rien d’autre qu’un échange entre personnes d’idées par une joute d’arguments, de questionnements et l’élaboration de raisonnements. C’est par une coopération dynamique et l’élaboration d’une pensée et d’un discours subtiles que les personnes philosophantes avancent, discutent et que l’interaction se fait philosophie. Recherche de vérité, amour du savoir, excitation face à l’inconnu ou au subtil...dans une « disputation » vivante l’étonnement réapparaît et l’enthousiasme de penser et de conceptualiser ensemble rejaillit.
Alors retrouvons notre naïveté et enthousiasme d’enfant et laissons-nous à nouveau émerveiller par la beauté des mystères du monde. Je vous invite ainsi à participer à des cafés Philo pour (re)découvrir le ou la philosophe qui sommeille en vous, pour désacraliser l’idée même de ce qu’est la philosophie, démocratiser une pratique vivante et humaine qui n’est pas uniquement réservée à une élite. Faisons face ensemble à nos peurs et dépassons-les avec humour autour d’un bon café.